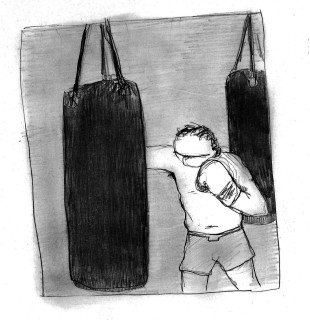Article paru le 13 décembre 2016 sur Les cahiers du bruit.
[divider divider_type=”type1″][/divider]
Fat City ne donne pas envie de faire de la boxe.

Pour tout vous dire,
Fat City ne donne pas envie de faire grand chose.
Une fois le livre posé sur la table de chevet, on se sent les jambes lourdes, les bras inutiles et la cervelle angoissée.

C’est un roman noir. Une noirceur avec des reflets, parfois. C’est un roman court, que parcourt une poésie sourde. Rien ne se passe très mal, à vrai dire. Et rien ne se passe très bien non plus.
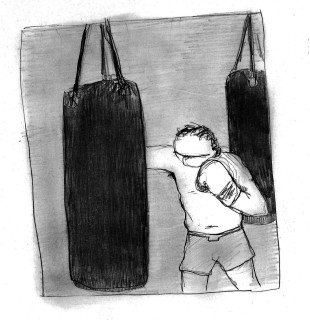
Publié en 1969 aux Etats-Unis, le texte esquive les lieux communs de la boxe professionnelle. Il navigue le plus souvent hors des rings, hors de la vue, dans les doutes, les petits boulots, les joues creusées, le mensonge des « carrières prometteuses ». Les yeux rivés sur « Fat City », expression argotique pour le pays de cocagne. Ce sera le roman des espoirs déçus, de ceux qui pensent y arriver un jour, de ceux qui ont pensé un jour y arriver.

On suit par à-coup les destins chiffonnés de trois hommes, trois boxeurs : Billy Tully, Ernie Munger et Arcadio Lucero. On navigue entre chambres d’hôtels, salles de boxe et salles de bar. On prend le car Greyhound, de Mexico à Los Angeles. On se retrouve le dos courbé dans un champ d’oignons pour faire les saisons. Il y a des scènes de ménage, des dialogues lassés, quelques combats sous les lumières, les vivas et les hurlements. La vie se déroule, elle racle, elle fatigue ceux qui l’empoignent, elle piétine ceux qui décrochent.

Dans
Fat City, la boxe n’est pas une métaphore. Leonard Gardner, lui-même ancien pratiquant, la connaissait trop bien. Au long des pages, elle ne devient pas un catalogue de clichés. Même en troisième zone, elle est un travail : celui d’hommes qui cherchent à se faire casser la figure au meilleur prix. Elle a ses exigences techniques. Ses parcours professionnels. Ses retraites anticipées.
Fat City – Leonard Gardner – 224 pages – Tristram